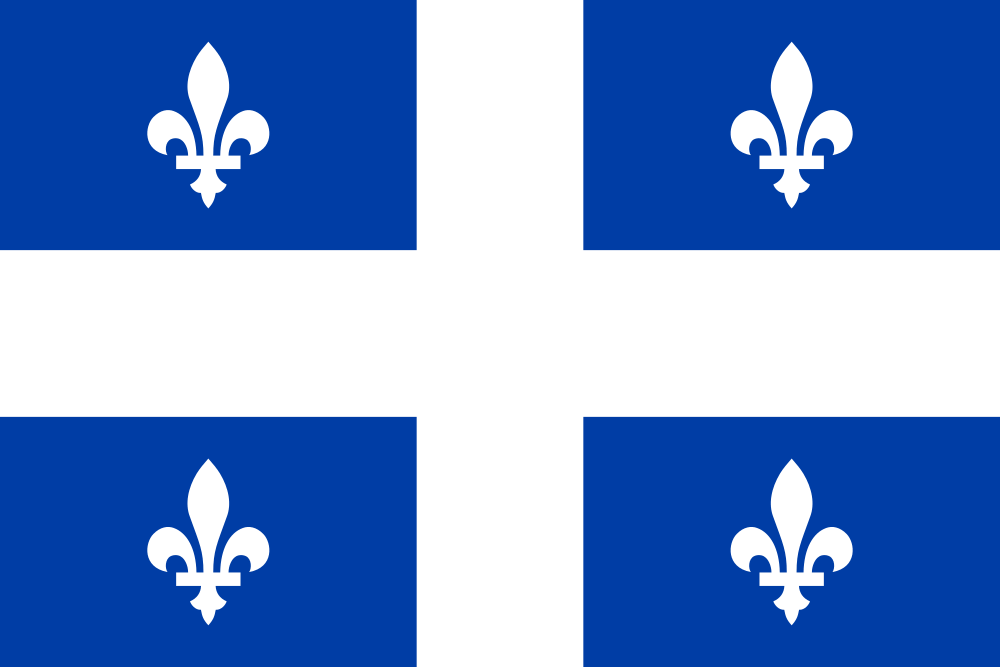Points Clés
- Dès qu’une employée enceinte présente un certificat médical attestant que ses conditions de travail peuvent être physiquement dangereuses pour son enfant à naître, ou pour elle-même en raison de sa grossesse, l’employeur doit activement évaluer et, lorsque cela est possible, offrir des tâches sécuritaires; le retrait immédiat de l’employée du travail est un dernier recours.
- Les employeurs doivent être en mesure d’articuler et, en cas de contestation, de prouver les mesures concrètes prises et les raisons pour lesquelles une réaffectation n’a pas été possible.
- Un refus de réaffecter—s’il n’est pas dûment justifié—peut constituer une « sanction ou mesure discriminatoire », ouvrant la porte à une plainte pour représailles.
Dans l’affaire Ville de Québec c. Ouellet, une sergente de police enceinte a demandé à son employeur, la Ville de Québec, de lui confier des tâches sécuritaires plutôt que d’être retirée du travail dans le cadre du programme dénommé Pour une maternité sans danger, en vertu duquel la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) verse une indemnité de remplacement du revenu. La ville a refusé. Lorsque le Tribunal administratif du travail (TAT ou Tribunal) a ensuite rejeté sa plainte pour représailles pour absence de compétence, la Cour supérieure du Québec a jugé la décision du Tribunal « déraisonnable » et a accueilli le pourvoi en contrôle judiciaire. La Cour d’appel a depuis rejeté l’appel de la ville.
Le jugement souligne que le mécanisme de retrait préventif est avant tout une mesure préventive visant à maintenir les travailleuses en poste lorsque cela peut être fait en toute sécurité. Bien que les employeurs ne soient pas garants d’une réaffectation réussie, ils sont tenus de rechercher des options et d’expliquer—de manière transparente—pourquoi une réaffectation est impossible. Le défaut de le faire peut exposer l’organisation à une plainte pour représailles en vertu de l’article 227 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).
Les moyens d’appel examinés
En examinant le rejet par le TAT de la plainte de représailles de l’employée, la Cour d’appel a abordé quatre motifs principaux avancés par la ville et a expliqué pourquoi chacun était insuffisant en droit.
Premièrement, la ville a soutenu que la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Dionne portait exclusivement sur la question du statut de travailleur et que toute référence à la réaffectation préventive en vertu de la LSST ne constituait pas un principe juridique contraignant. La Cour d’appel n’était pas d’accord, soulignant que Dionne fournit une déclaration faisant autorité sur l’objectif général de la LSST : la réaffectation est le mécanisme privilégié par la législation pour assurer la santé et la sécurité d’une employée pendant la grossesse ou l’allaitement. En traitant les orientations de Dionne sur la réaffectation comme facultatives, le TAT a appliqué le mauvais critère juridique, rendant sa décision déraisonnable.
Deuxièmement, la ville s’est appuyée sur une lecture purement textuelle des articles 40 et 41 de la LSST, notant qu’un employé « peut demander » une réaffectation préventive et « peut cesser de travailler » si aucune n’est offerte, et a déduit de cette formulation l’absence de toute obligation de l’employeur d’accommoder. La Cour d’appel a jugé qu’une telle approche littérale est incompatible avec le principe moderne d’interprétation législative, qui exige que les tribunaux lisent les mots d’une loi dans leur contexte global et tiennent compte de l’objet réparateur de la loi. Lorsque les débats législatifs et la structure générale de la LSST sont pris en compte, il devient évident que le retrait du travail est censé être une solution de dernier recours ; l’employeur doit d’abord faire des efforts raisonnables pour réaffecter l’employée à des tâches sécuritaires. L’obligation est une obligation de moyens plutôt que de résultat garanti, mais elle demeure néanmoins une obligation positive que le TAT était tenu de reconnaître.
Troisièmement, la ville a invoqué le Programme pour une maternité sans danger, affirmant que celui-ci confirme que la réaffectation est facultative. La Cour d’appel a noté que ce programme ne fait que réitérer le régime légal : bien qu’un employeur ne soit pas tenu de produire une réaffectation à tout prix, il doit activement en chercher une. Les lignes directrices administratives ne peuvent pas prévaloir sur la législation ou l’interprétation judiciaire. Par conséquent, le recours au programme n’a pas libéré l’employeur de son obligation légale, ni justifié le défaut du TAT d’analyser si la ville avait rempli son obligation de rechercher un travail alternatif approprié.
Enfin, la ville a soutenu que l’article 227 de la LSST—qui interdit les représailles contre les employés exerçant un droit en vertu de la loi—ne pouvait pas s’appliquer parce qu’un refus de réaffecter ne constitue pas une « sanction ». La Cour d’appel a rejeté cet argument, observant que l’article 227 protège les employés contre les conséquences défavorables découlant de l’exercice de tout droit prévu par la LSST, y compris le droit à la réaffectation préventive. La question de savoir si le refus de l’employeur de réaffecter constitue une sanction est une question de fait réservée au TAT sur le fond ; toutefois, le Tribunal a commis une erreur en déclinant compétence à un stade préliminaire.
Après avoir écarté les objections de la ville, la Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour supérieure et a renvoyé l’affaire au TAT pour qu’il statue, sur la base de la preuve, si la conduite de la ville constituait une sanction interdite en vertu de l’article 227 de la LSST.
Conclusion
Ville de Québec c. Ouellet précise que le retrait préventif n’est pas la solution automatique et par défaut lorsqu’une employée enceinte fait face à des dangers au travail. L’employeur doit d’abord tenter de trouver un travail approprié, sans danger, et doit être prêt à justifier sa conclusion si un tel travail n’existe pas. La décision s’aligne sur l’approche préventive et axée sur la rétention des travailleuses de la LSST et trace une feuille de route claire en matière de litige : des efforts de réaffectation inadéquats peuvent entraîner une responsabilité en vertu de l’article 227 de la LSST. Les employeurs québécois pourraient vouloir revoir leurs protocoles d’accommodement en matière de maternité, en s’assurant de recherches de réaffectation rigoureuses, de dossiers méticuleux et d’une communication transparente—bien avant que la prochaine demande de réaffectation ne leur soit soumise.
Le bureau de Montréal d’Ogletree Deakins continuera de suivre l’évolution de la situation et publiera des mises à jour sur les blogues du cabinet concernant les affaires transfrontalières et congés d’absence à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.
Pour nous suivre
LinkedIn | Instagram | Webinaires | Balados